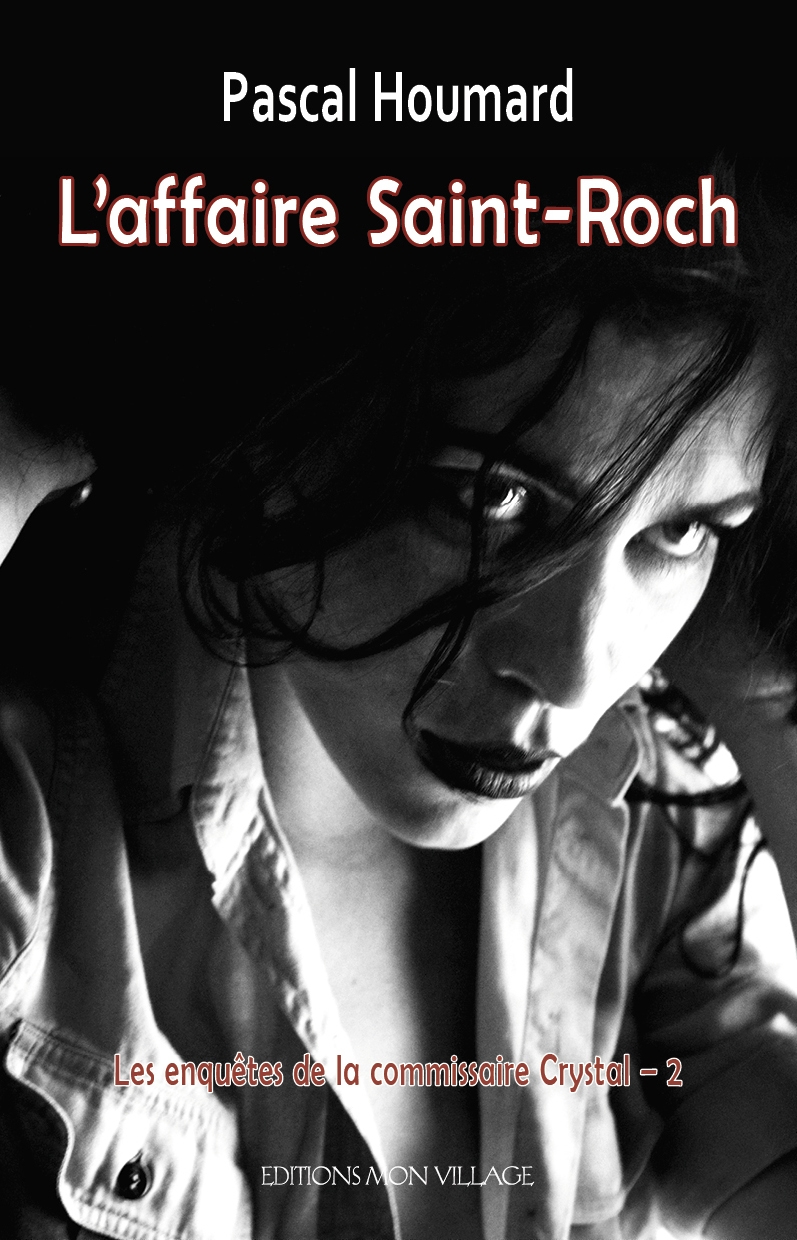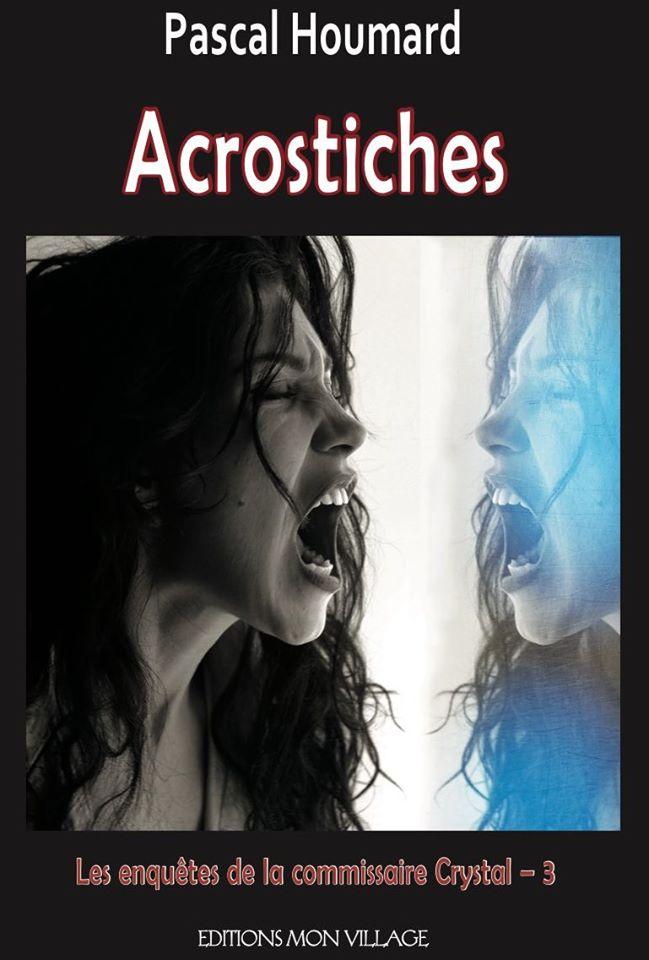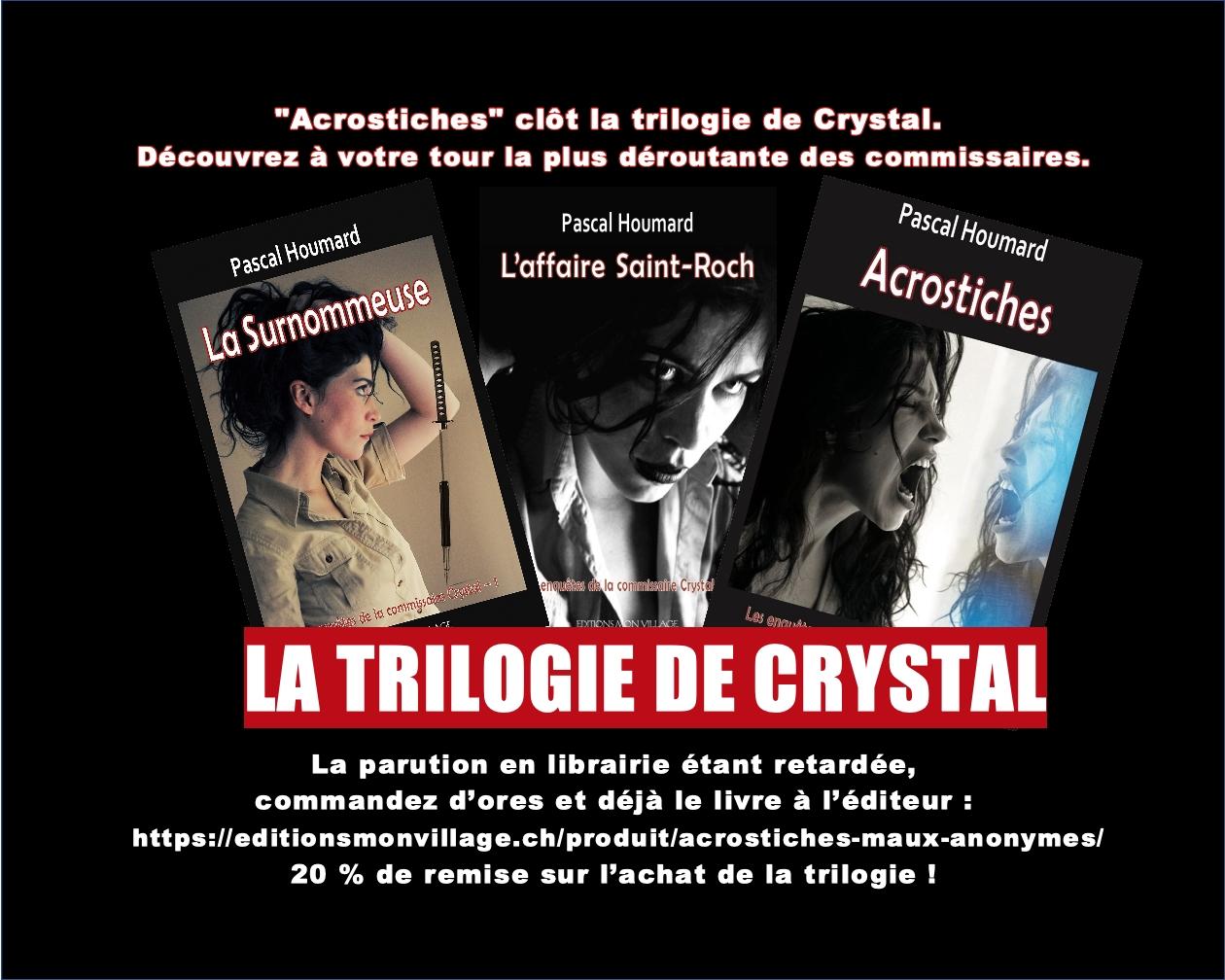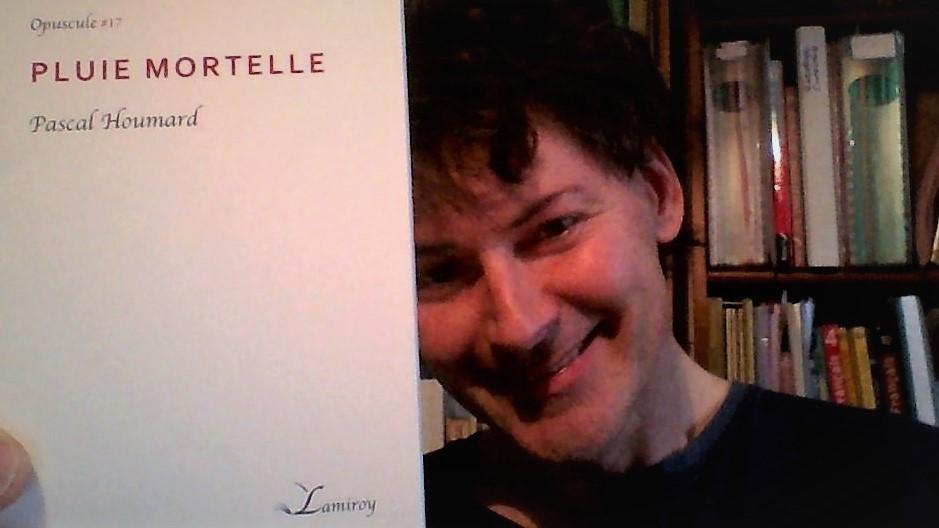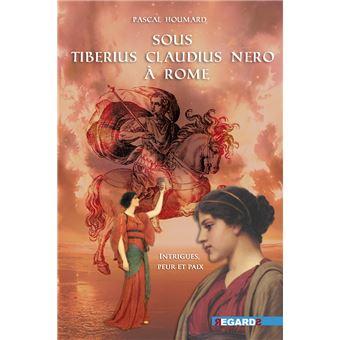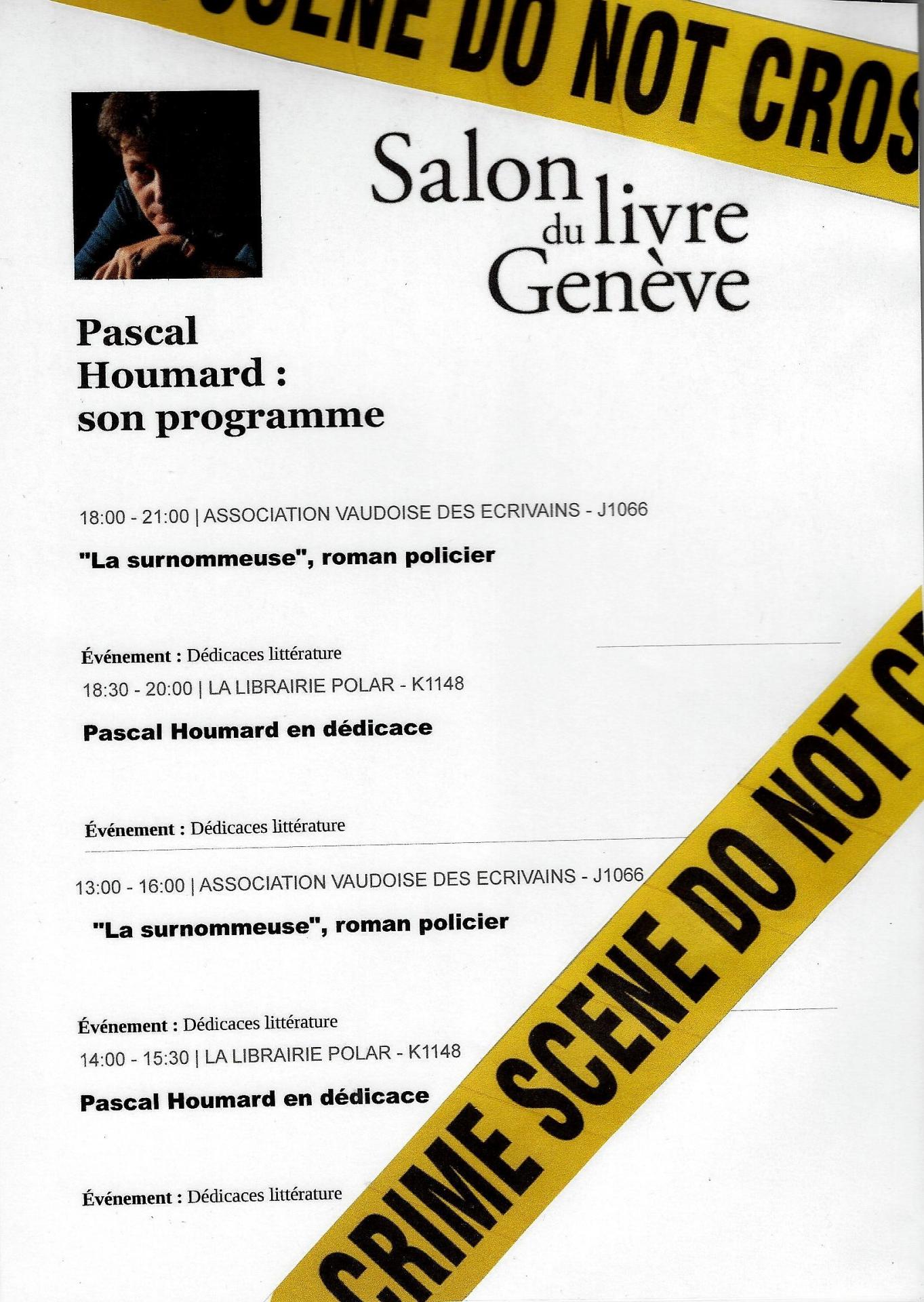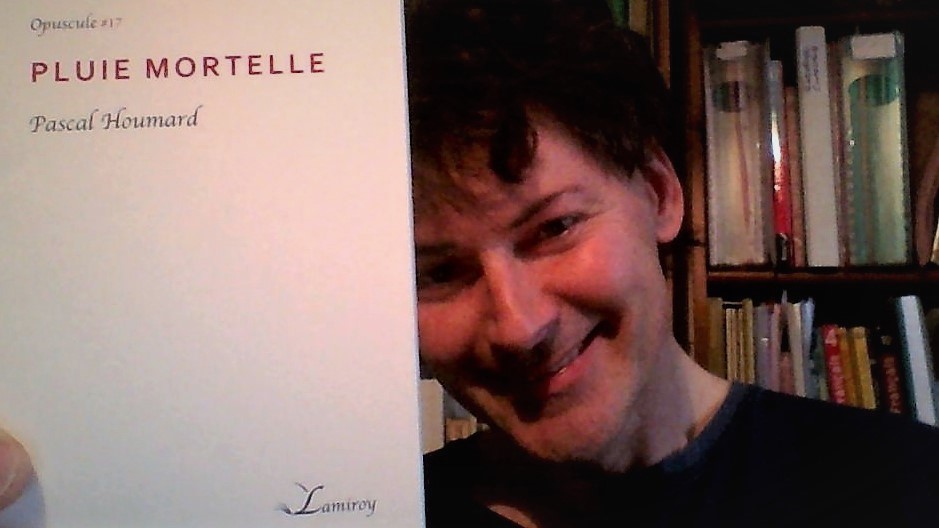Pince sans rires
Pince sans rires Agglomérée au pavé, devenue béton comme lui, presque empreinte désormais, fossile d’une ère industrielle révolue. Cette pince comme un dessin, comme un fantôme de pince, sous ses pieds, sous ses doigts. Aucun relief au toucher, impossible de l'extirper, même avec une autre pince ! Et inutile de chercher à l’effacer : ses contours ont l’inconsistance du passé, ses couleurs, la rémanence des cauchemars.
Agglomérée au pavé, devenue béton comme lui, presque empreinte désormais, fossile d’une ère industrielle révolue. Cette pince comme un dessin, comme un fantôme de pince, sous ses pieds, sous ses doigts. Aucun relief au toucher, impossible de l'extirper, même avec une autre pince ! Et inutile de chercher à l’effacer : ses contours ont l’inconsistance du passé, ses couleurs, la rémanence des cauchemars.
Seuls des pleurs d'enfant pouvaient le détacher de cette énigme passionnante. Sami tourne la tête dans la direction d'où proviennent les gémissements : assise seule sur un banc, une fillette de son âge vide toutes les larmes de son petit corps et sa peau ébène semble si noire qu’en comparaison, celle du garçon, bien mate pourtant, passerait pour claire.
Le gamin se redresse et court jusqu'à l'autre banc public, occupé par un homme à l’ombre trop grande, silhouette immobile aux traits pétrifiés, encore une énigme pour Sami qui se demande, comme auparavant avec la pince, s'il n'a pas affaire, là aussi, à un dessin, un fossile, un fantôme de père.
- Je t'en prie ! supplie-t-il tout de même, supplie-t-il surtout, les paupières implorantes, cherchant sans le trouver le regard paternel. On ne peut pas la laisser pleurer ainsi !
L'adulte ne réagit pas, fût-ce d’un cillement d’yeux : le fait est qu'il observait déjà la fillette. Abandonnée par ses parents ? Égarée à travers cet étourdissant lacis de rues et de places qui enferment les étrangers en un véritable labyrinthe ? À peine débarquée dans un havre inconnu ? Détachée de ces colonnes d'enfants migrants toujours nombreux à surgir du chaos ? Ce n'est pas qu'elle gémisse bien fort : ses lamentations, la maigre conversation de toxicos regroupés non loin parvient à les couvrir, mais elles résonnent trop profond contre les parois de son cœur de père pour qu’il fasse la sourde oreille plus longtemps.
- Tu penses qu'elle vient d'Afrique ?
L'homme s'approche de la gosse en pleurs, sans répondre à son fils, qui s’attache à ses pas. Étonnamment, elle est plutôt bien vêtue, rien à voir avec des habits de seconde main, comme il s’y serait attendu, tant on dit que les Européens se débarrassent ainsi de leur superflu, quand ils ne le jettent pas à la poubelle. Parce qu'on ne trouve plus, parmi son entourage, à qui refiler le périmé. Parce qu'il y a ces habits qu'on ne veut pas revoir portés par d'autres, attaché qu'on reste à la personnalité qui les a remplis, aux moments exclusifs qu'on leur associe. Sans parler de ces guenilles qu'on n'osera jamais donner à des connaissances, si vrai que ça ne se partage pas, une déchirure au genou, une usure du col, une tache de cerise qui a résisté à tous les efforts. Et les pauvres se délectent de ce dont les riches se délestent.
- Elle est bien fagotée mais mal dans ses baskets, résume Sami.
- Ce doit être une tristesse pour le fond plutôt que pour la forme.
Approche toute douce où l'adulte ouvre ses bras en signe d'accueil, met un genou à terre pour subordonner sa taille à celle du chagrin de la petite, laquelle cesse ses pleurs en percevant la double présence.
- Why do you cry ? What's your name ? Where're your parents ?
Aux yeux mouillés succède un regard d'incompréhension, les lèvres agitées dessinent une bouche béant de surprise. À grand renfort de signes et de mimiques, Sami parvient à lui extorquer un prénom.
- Laura, c'est africain, ça ?
- Ce n'est pas parce qu'elle a la peau noire qu'elle vient d'Afrique, fiston !
L'air désemparé, la fillette regarde ses deux secouristes en ravalant ses sanglots. Le garçon lui offre un mouchoir qui a déjà servi mais qu'elle utilise sans renâcler.
- J'aimerais bien savoir, reprend Sami, ce qu'elle a pu vivre avant d'arriver ici.
Vivre. Après les lamentations de Laura, c’est à ce mot de résonner dans son cœur de père. Vivre. Vivre ? Survivre, oui, voire sous-vivre. Car après avoir été soumis, il ne reste plus qu'à subir. C'est ainsi. La porte qui tremble sur ses gonds au petit matin. Les cinq minutes qu'on vous laisse pour embarquer le plus d'affaires possible, ou le moins, question de point de vue. Les cinq autres minutes pour faire de la maison qui rapprochait la maison qui s'éloigne, pour fuir les balles, cruellement clémentes quand elles ricochent contre les arêtes des murs, pour échapper à la déflagration assourdissante d'une bombe. Et la marche rapide qui devient pas de course, les vivants qui deviennent morts en tombant tout autour, les rescapés qui deviennent ombres sans soleil, sous-hommes sans âme, mécaniques sans ressort, juste bonnes à sauver leur peau sans plus rien sacrifier, rien, même une seconde de survie, un mètre de marathon, à ceux que frappe le sort, voisins, amis, parents, fût-ce ces rebelles qui viennent de leur sauver la vie. Sauver, oui, parce qu’en se retournant, on peut désormais les voir, les montagnes : plus de toits élevés pour voiler ce massif qui s'étend paisiblement sur les régions en guerre, cette bande unie plissée de partout, comme une nappe gigantesque dressée depuis la création en vue du banquet final.
- Tu penses qu'elle a vécu quoi, papa ?
Mais trop occupé à refréner ses larmes, à contrôler le tremblement de ses lèvres, il ne laisse pas échapper un traître mot. Alors, Sami en rajoute, non par cruauté – celle, naïve, de l'enfance, qui ne le cède jamais qu'à la méchanceté calculée des adultes –, mais pour donner à son père l'occasion de se lâcher, de pleurer à son tour, parce que ça fait trop mal de retenir ses larmes, il le sait bien, Sami. Et le gamin de rappeler ces maisons de plastique et de tissu qu'on nomme des tentes et où les fugitifs se résignent à survivre, et la poussière qui s'infiltre partout, qu'on chasse par gestes vains, comme peut-être Laura faisait en Afrique avec les mouches... À l’entendre évoquer la poussière, le père à son tour se souvient : elle n’était pas faite seulement de terre, mais aussi de mort, de la cendre froide que libèrent, par la grâce d'un souffle divin, les cadavres qui jonchent le sol au loin et tapissent, en bornes sinistres, la route menant au village disparu. D'abord dégoûté, on finit par s'accoutumer à cette poussière, on se surprend même à s'en saupoudrer affectueusement, aux jours où tout rappelle que parmi les dépouilles délaissées en bordure de chemin figure celle d'une épouse, d'une maman... Mais le cœur, à l’instar des autres organes, se ratatine, prend chaque jour un peu moins de place, au détriment de l'estomac. Ah, ce ventre, pour lequel on s'inquiète la journée durant, qu'on honore en processions interminables devant des camions vides, qui empêche de dormir la nuit, rythme les activités, les pensées, censure les rêves et amène à maudire sa propre humanité, sa sale humanité.
Sami, qui ne s’est pas arrêté de parler, en vient à décrire le jeu triste créé à partir de cailloux et de lambeaux d'un drapeau de Daesh, à mentionner les tanks hérissés d'hommes eux-mêmes hérissés d'armes et dont...
- Arrête !
Dans un rayon de dix mètres, tout le monde, même la bande de toxicos, se retourne vers l'homme aux larmes rugissantes. Laura aussi qui, comme elle a levé la tête, aperçoit au bout d'une allée ses parents déambulant d'inquiétude entre les différents étals du marché.
Une seconde pour sauter du banc, une autre pour rejoindre papa et maman : ses baskets, elles sont rapides, pas seulement jolies, se dit Sami qui pense qu'avec les siennes, il n'arriverait jamais à cavaler aussi vite.
Son père et lui assistent de loin à la scène des retrouvailles : moment poignant, mais dépourvu de saveur et de sens pour qui plus personne ne reste à retrouver.
Piétinant un soupir à chacun de leurs pas, père et fils s'en retournent à leur banc, désormais occupé par un couple d'amoureux. Indélogeable.
C’est alors que Sami s’apprête à rejoindre le pavé à la pince que son père est abordé par les parents de Laura : couple enveloppé d'émotion, drapé dans la soie, comme sorti d'un film, portant les accessoires essentiels des gens qui savent vivre, mais qui n'ont pas eu et n'auront jamais besoin de survivre.
- Notre fille nous a appris comment vous vous êtes occupé d'elle, merci ! fait le monsieur, en lui serrant la main.
- Vous... anglais ?
- Pardon ?
- Je crois qu'ils ne parlent pas notre langue, chéri !
- Oh, vous... Are you coming from Turkey ? Or Syria ?
- Yes, répond Sami, à la place d'un père dont les lèvres se sont remises à trembler. Alep, you know ?
- Quelle horreur ! s'écrie la dame, sur ce ton impudique que dégaine parfois la spontanéité. Et, pour racheter cette réaction, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de pêcher dans son porte-monnaie un billet de cinquante francs. For your child, précise-t-elle, en tendant l'argent à l'homme qui le reçoit sans mot dire.
S'il attache son regard au papier vert plutôt qu'au sourire écarlate qu'elle voulait surtout lui offrir, c'est, pense-t-elle, qu'il n'a jamais eu en mains de si grosse coupure, pire, qu'il est torturé par la honte.
Après le départ de la famille suisse, Sami, brûlant de contempler le billet, vient s’agripper au bras de son père : ce dernier, négligeant la valeur du papier vert, n'a d’yeux que pour la montagne qui y est représentée, une montagne qui lui en rappelle d'autres, celles que la paix masquait depuis l'ombre des maisons aux toits encore debout et qui forment un ensemble prodigieux et sacré, façonné de toute éternité par Allah... Allah. Le seul à pouvoir tout remodeler ? Ou faut-il voir dans ces plis montagneux la peau fripée d’un dieu décati ?
- Ces tons de vert, lâche enfin le père. Les mêmes que sur nos cinq livres syriennes !
- Vert, c'est pas la couleur de l'espoir ? lâche Sami, déjà retourné à son drôle de pavé.
L’adulte le rejoint : cette pince semble tenir au béton comme l’espoir au fond du vase de Pandore. Puis il observe ce bout d'homme pour lequel il reste le seul compère, le dernier repère, un père, tout simplement, et ses lèvres tremblent à nouveau, mais différemment, cette fois, quand elles viennent se poser sur la joue de son fils.
Pascal Houmard, février 2018